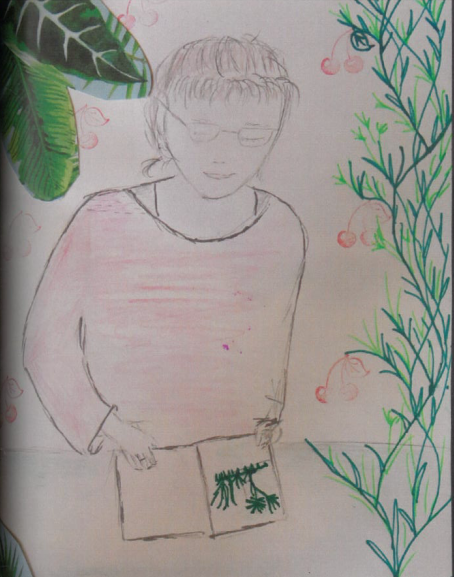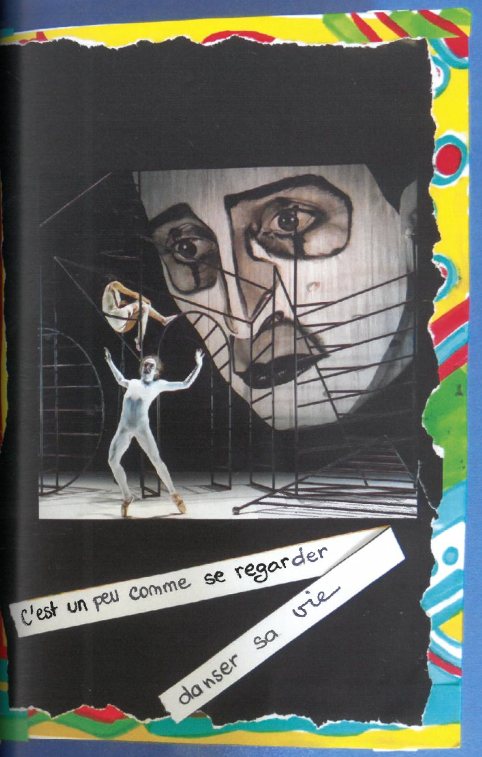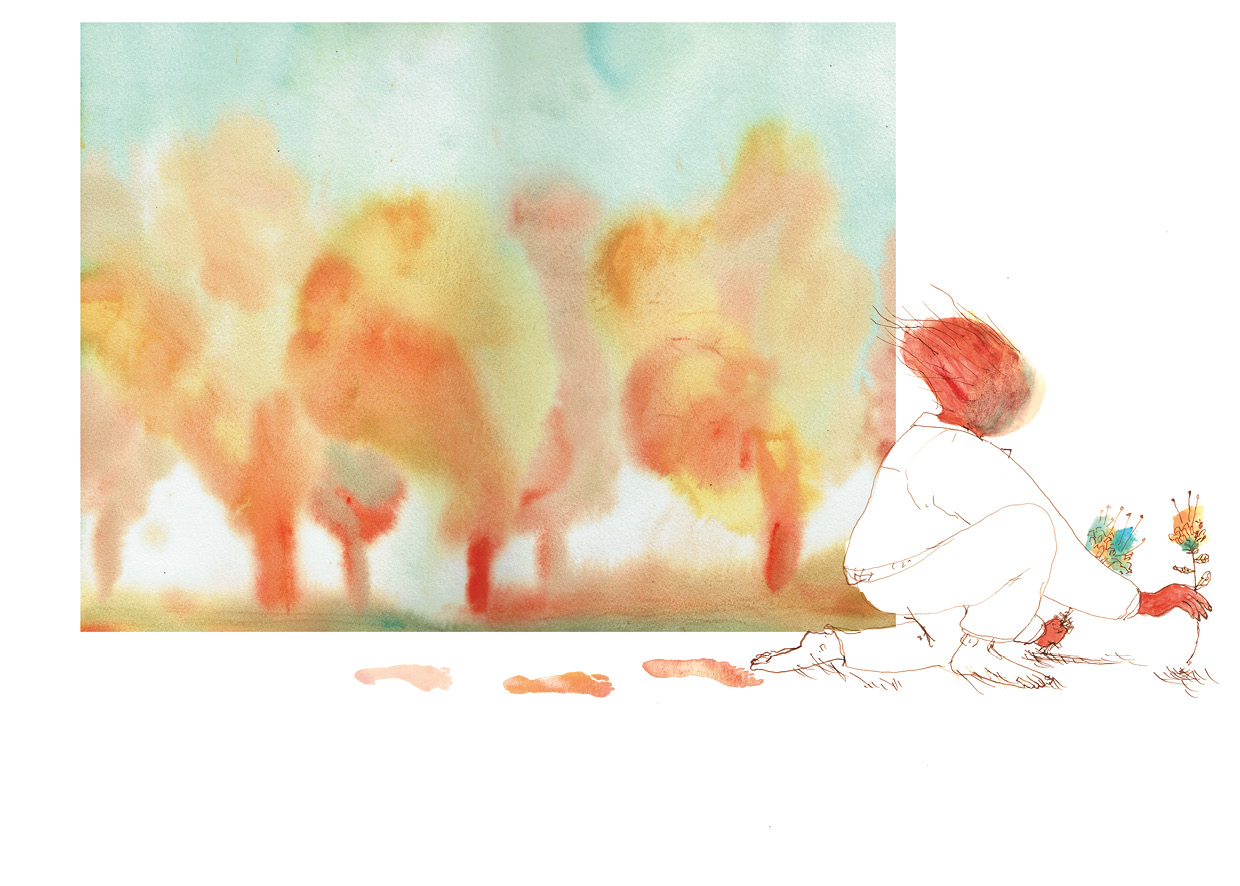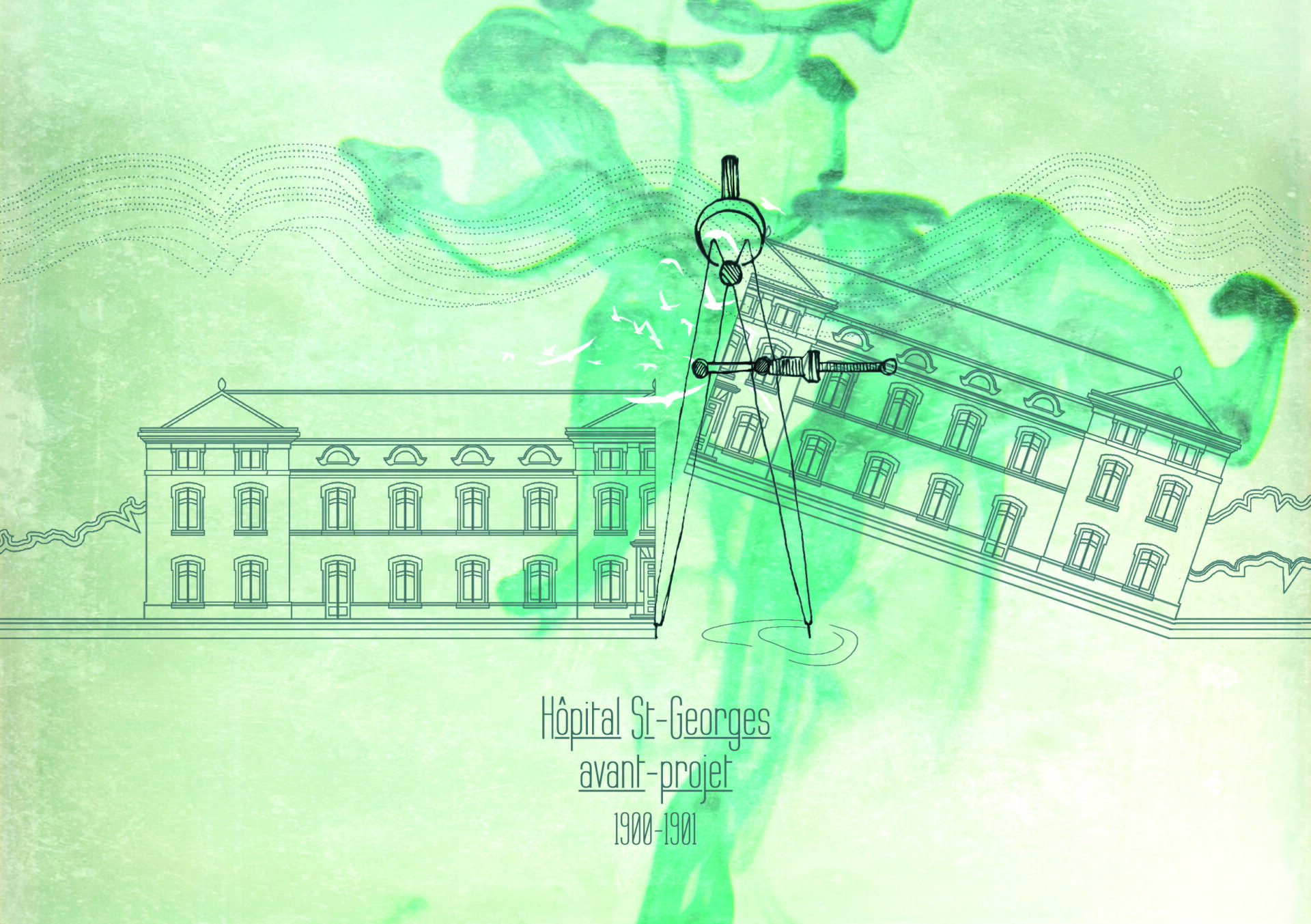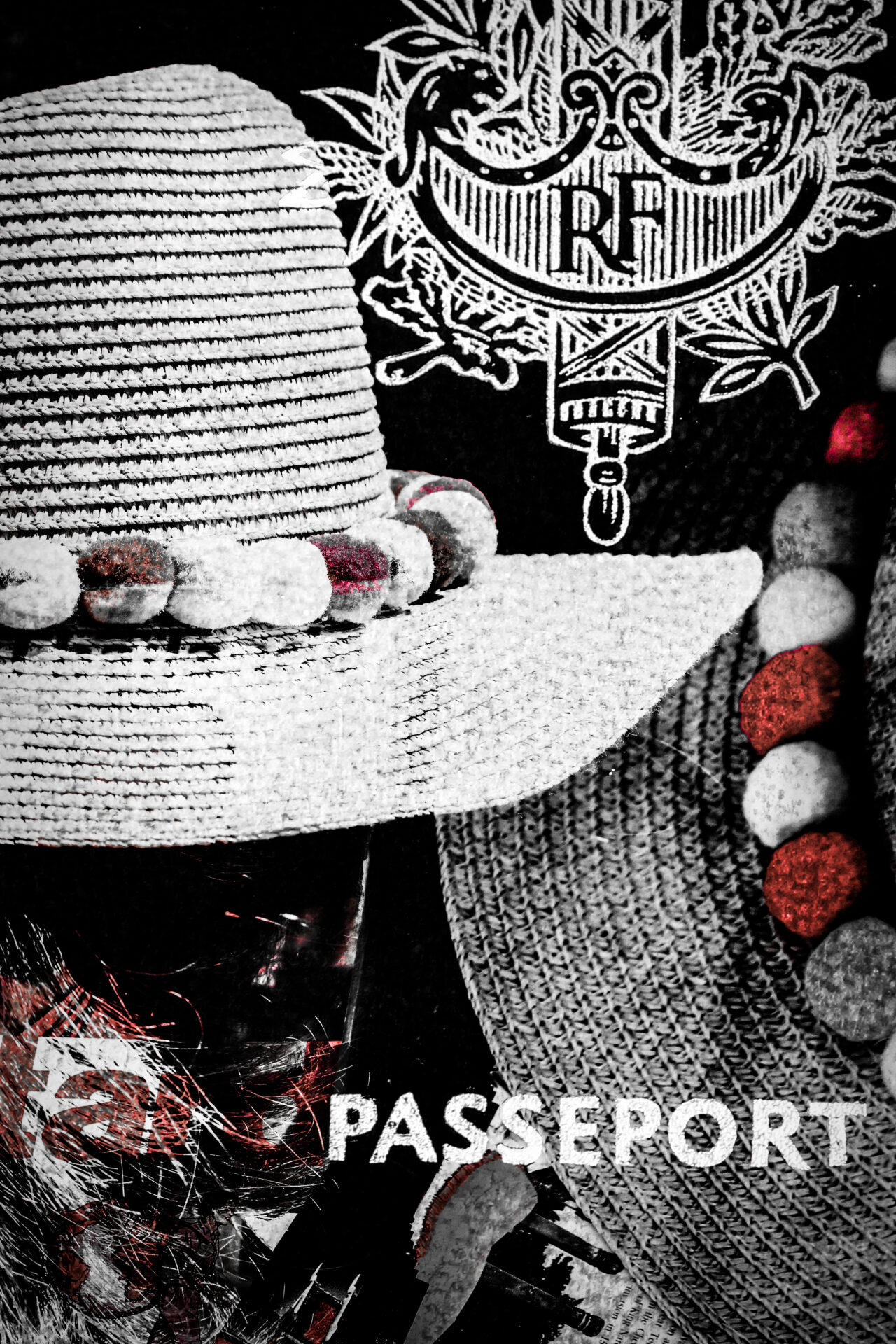La psychologie positive voit le jour à la fin du 20ème siècle avec les travaux de Seligman. Pour lui, la psychologie scientifique devrait aider chaque individu à trouver un équilibre vers le bien-être plutôt que de trouver des solutions à des problèmes. « La psychologie positive considère qu’en dehors des problèmes individuels et collectifs s’exprime toute une vie riche de sens et de potentialités. Il s’agit alors de les faire émerger ou de renforcer les ressources de chacun, tant pour l’aider à mieux résister aux événements difficiles que pour optimiser sa vie dans les dimensions affective, sociale et professionnelle ».
La psychologie positive valorise les expériences positives et se centre sur ce qui permet de construire des qualités positives, plutôt que sur la pathologie ou la souffrance psychique. Cela ne veut pas dire qu’elle met de côté les connaissances acquises sur la souffrance psychique, mais elle considère qu’à côté de ces problématiques psychiques se développe toute une vie riche de sens et de potentialités. Elle s’intéresse à ce qui rend les gens heureux.
En 2002, Seligman et Csikszentmihalyi, pionniers de la psychologie positive ont déclaré que « le bonheur n’est pas quelque chose qui apparaît juste comme ça… il s’agit d’une condition qui doit être préparée, cultivée et défendue par chaque personne ».
Plus tard, Seligman (2011) fait le constat que la notion de bonheur est une construction maladroite qui cache la vraie nature complexe de l’épanouissement humain : « J’étais habitué à penser que l’objet principal de la psychologie positive était le bonheur… Je pense maintenant que l’objet principal de la psychologie positive est le bien-être, dont le point de référence de mesure est l’épanouissement. Et le rôle de la psychologie positive, c’est d’accroître cet épanouissement ».
Il propose alors une nouvelle théorie du bien-être se démarquant du bonheur, qui se concentre sur les éléments constitutifs d’une vie épanouie.